Ozark est une beauté de série. Ou, comme le poserait Baba Hanouna le Magnifique : « C’est une bête de série mes petites beautés ! »
Cette introduction à une chronique qui vante la qualité d’un format que j’adore, et dans lequel je réussis à glisser un clin d’oeil narquois au vide ultime de la pensée au service de la putasserie télévisuelle, démontre sans coup férir, s’il était besoin d’enfoncer le clou dans la réalité de la vacuité de mon existence sur cette Terre qui n’a rien demandé à ce que je sais, l’état schizotaquin qui agite nerveusement le flux de mes pensées, dans lequel je vous défie de trouver une ligne directrice vers un objectif que je chercherais à atteindre depuis mes parties d’osselets dans la cour de l’école Sainte-Thérèse, là-bas dans la Comté, où nous sucions le miel de la susdite Terre sous le regard bienveillant de Valery le Gentil.
En résumé, je navigue à vue.
Pour écouter cette chronique en audio 👇
Quant à Ozark, le scénario se rapproche de Breaking Bad par son côté sombre, cette face que les cordées de scénaristes américains savent gravir avec brio depuis The Wire, si vous voulez mon avis et même si vous ne le voulez pas c’est trop tard parce que j’écris encore ce que je veux, on est pas en dictature !
Les deux acteurs principaux sont impeccables : je suis un grand admirateur (coeur avec les doigts) de Jason Bateman depuis les temps jadis d’Arrested Development, et Laura Linney m’avait ému aux larmes dans Love Actually (voir plus loin quant à l’état d’« absolutely fleur bleue » de votre serviteur, c’est une expression, je ne sers pas à grand-chose… ça, c’est une minauderie ridicule).
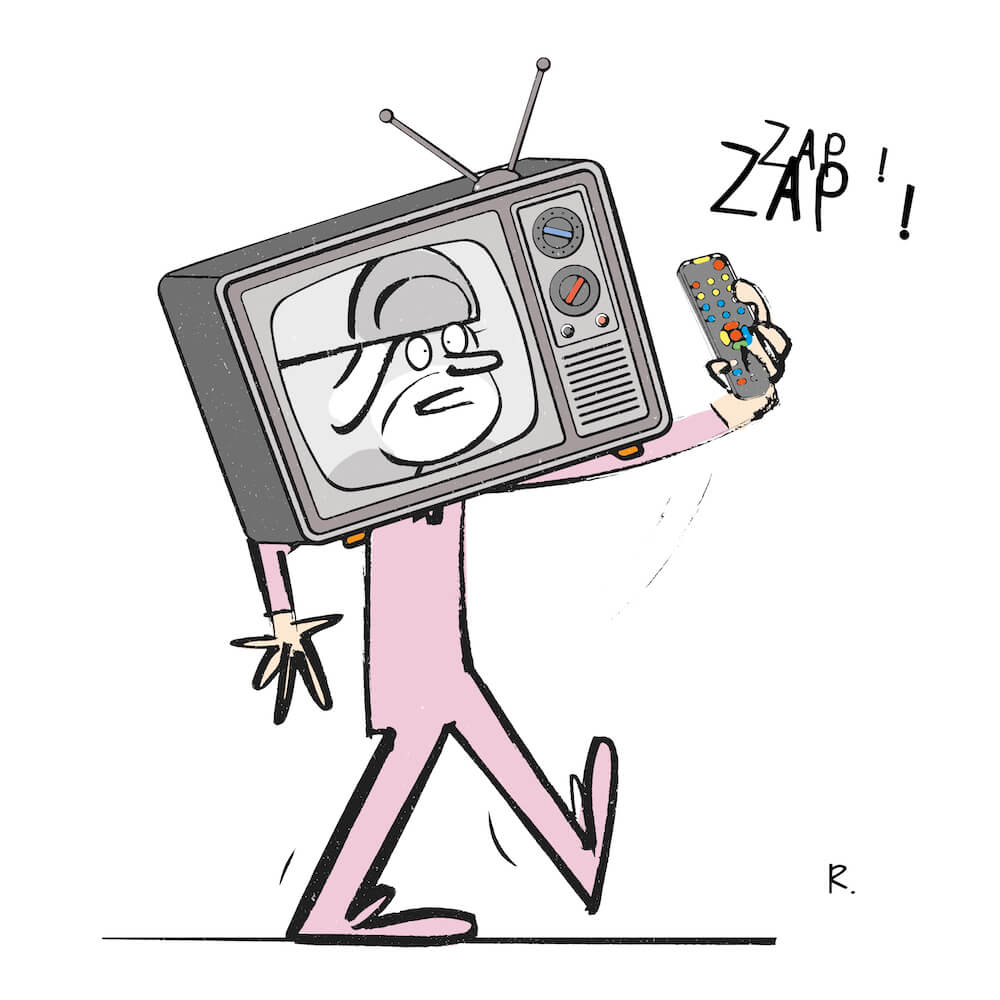
Rapaport, Mars 2022
C’est sombre. Le dark mode est activé de bout en bout, et la moitié d’une des matinées des Byrde m’aurait suffi à dire « stop, s’il vous plaît faites de moi ce que vous voulez, mais arrêtons là je n’en peux plus ».
Ozark, le scénario au top, les acteurs géniaux, la réalisation a parfois des touches Michael Mann (celui de Collatéral mais aussi celui de Deux flics à Miami et surtout pas celui de Hacker !)…
OK mais qu’est ce qui vaut que j’écrive sur cette série, excellente certes, et pas une autre alors que je cumule près de 13 500 heures de visionnage d’épisodes divers, et avariés pour certains, depuis cette époque avec les osselets dont j’ai parlé plus haut et que je ne suis pas critique de série (ni de quoi que ce soit d’autre) à ce que je sache ?
Le retour de l’acteur disparu dans les limbes d’un trouble passé
Cela tient à un acteur, dont le nom me renvoie à une époque trouble de ma courte vie, une ironie parce qu’en ce temps-là je voyais parfaitement bien. ESAI MORALES (prononcez-le comme vous le souhaitez, je ne sais pas comment cela se dit). Onze lettres qui sonnent comme les douze coups de minuit me renvoyant à cette époque tel Marty McFly, avec une barbe blanche mais toujours sur un skate et une casquette vissée sur le crâne (« cela voudrait-il dire que… ? Non… vous plaisantez Docteur… Peter Pan ? Foutaises ! »).
Esai Morales, LE méchant de la saison 1 d’Ozark, que j’ai reconnu de suite comme étant, alors qu’il tentait de se cacher sous les oripeaux d’un personnage à l’âge avancé se prenant pour un Ulysse latino peut-être, CRUZ CASTILLO, l’amoureux à jamais de Kelly Capwell dans ce feuilleton télévisuel magnifique qu’était Santa Barbara !

Rapaport, Mars 2022
Oui, lecteur, tu m’as bien lu ! Monsieur Châtellier, à l’âge d’homme où on lui donne du « vous » à tu et à toi lâche une bombe : il regardait un feuilleton américain dans sa folle adolescence. Adolescence qui ressemble de plus en plus à un millefeuille de bazar ensouké, les chroniques se succédant et ne se ressemblant pas, loin de toute la cohérence attendue dans la construction de l’humain empli de sagesse qui passe le Rubicon et dévale la pente vers la lumière au bout du tunnel (reprendre plus haut ma certitude d’être schizotaquin depuis l’enfance)…
STOP ! Arrêtez tout ce que vous faites !
Cette chronique devient encore plus étrange, c’est le paroxysme du n’importe quoi que je ne comptais pas atteindre de sitôt : je viens d’apprendre qu’Esai Morales ne jouait pas Cruz Castillo dans Santa Barbara. Je le confonds avec Adolfo Martinez, que je prie humblement de m’excuser pour ce faux pas.
Ainsi naquit la pire des chroniques
Je suis contrit et sans doute il y a ici une leçon sur les biais de jugement que Ceux qui nous succèderont se feraient une joie de m’asséner si seulement j’avais à cœur de les écouter (alors que bon, avouons-le avec honnêteté, ce n’est pas comme cela que fonctionne les zenfants). Je suis dévasté parce que cela veut dire que la mémoire télévisuelle encyclopédique dont je me targue à hue et à dia (deuxième épisode des expressions sans queue ni tête) ne serait plus ce qu’elle était. Si jamais elle le fut. C’est une honte, une disgrâce. Je peux me tromper, et c’est une leçon de vie que je prends avec vous.
Pour alourdir ma chute, je lis que Cruz était l’amoureux d’Eden, la sœur de Kelly interprétée par Robin Wright. Oui vous avez bien lu : Robin WRIGHT. Et Cruz était amoureux de la sœur du personnage joué par Robin Wright. Mais comment peut-on ne pas être amoureux de Robin Wright ? En me relisant (oui je me relis), je me demande si l’addiction du jeune vierge effarouché de ces années-là pour ce soap-opera-là n’aurait pas comme origine un coup de cœur pour la future Mme Sean Penn.
Ce serait tellement plus simple.
Plus simple que d’avouer le cœur en porte-étendard que je n’en pouvais plus chaque fin d’après-midi, que je quittais les bancs du lycée en courant et replongeais dans les batailles des Capwell et Lockridge, ces Capulet et Montaigu de Prisunic (le LeaderPrice de ce temps-là) de cette Californie de carton-pâte mâchouillée comme les Américains seuls savent le faire parce que j’étais indubitablement, irrémédiablement et désespérément atteint du « syndrome de la fleur bleue », une terrible maladie dont je me défis un peu plus tard en allant poursuivre des études, sans succès (je suis nul à la course), et surtout faire de moi un homme un vrai, nourri à la bière et aux frites du Flunch, ce qui est un remède très efficace contre la maladie guimauvienne et débilitante susmentionnée.
Il n’empêche que parfois il m’arrive encore de chantonner dans mon for intérieur (derrière les barricades d’une vie) ce refrain, et l’âge venant j’ai peur de faire une rechute !
« Santa Barbara, qui me dira
Chanson de générique ultime, 1987
Pourquoi, j’ai le mal de vivre ?
Santa Barbara, je ne sais pas
Je vais, comme un bateau ivre
Emportant mes souvenirs »
Play-scriptum : en écrivant cette chronique j’écoutais It’s Good To Be Back par Metronomy, Prince of Tears de Baxter Dury et I Didn’t Change My Number de Billie Eillish (et ouais !)
